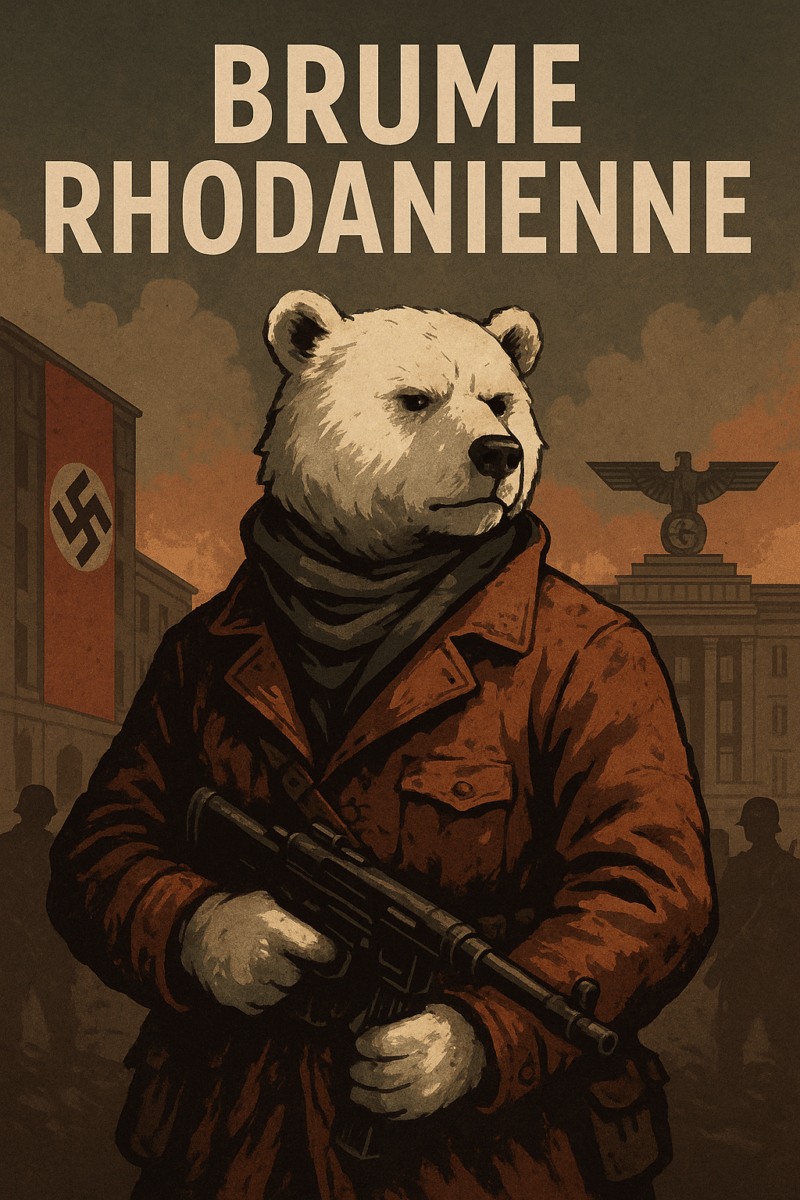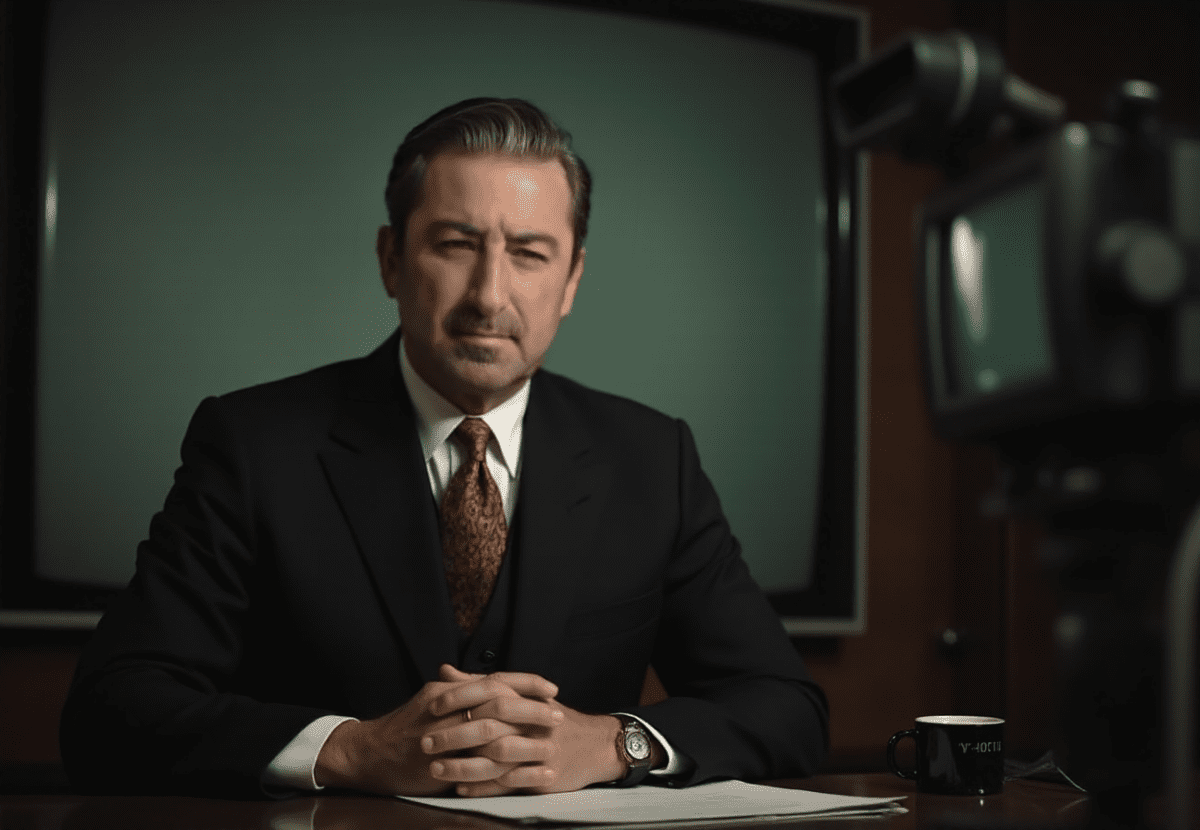Histoire Valence Drôme : Patrimoine et Culture

Antiquité
Valence trouve ses origines à l’époque romaine. La colonie de Valentia (signifiant « vigueur ») est fondée en 121 av. J.-C. dans le sillage de la conquête de la Gaule du Sud par Rome (Vieux Valence — Wikipédia). Implantée sur le territoire du peuple gaulois des Segovellaunes, la nouvelle cité occupe un emplacement stratégique au carrefour des grandes voies romaines de la vallée du Rhône, ce qui en fait rapidement un relais important, l’un des principaux pôles urbains entre Lugdunum (Lyon) et la Méditerranée (Vieux Valence — Wikipédia) (Vieux Valence — Wikipédia). La ville romaine est aménagée selon un tracé orthogonal hérité du cadastre romain, dont subsiste l’orientation générale de certaines rues du centre ancien actuel (Vieux Valence — Wikipédia).

Au cours de la période gallo-romaine, Valence se dote des infrastructures caractéristiques d’une cité prospère de l’Empire. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence la présence d’un théâtre romain dans le quartier Saint-Jean et d’un cirque (hippodrome) dans le quartier qui a conservé le toponyme du Cire, ainsi que les fondations d’un petit odéon à proximité de l’emplacement de la cathédrale (Vieux Valence — Wikipédia). L’existence d’un amphithéâtre a également été suggérée d’après des vestiges indirects, ce qui témoigne de l’importance de Valentia à l’époque impériale (Vieux Valence — Wikipédia). Bien que la cité fût florissante – l’historien Ammien Marcellin la décrit au IV^e siècle comme l’une des villes remarquables des Gaules, aux côtés de Vienne et Arles (Les origines de la colonie romaine de Valence. – Persée) – elle n’a conservé presque aucun monument romain visible de nos jours. Les constructions antiques ont été en grande partie détruites ou recouvertes par l’urbanisation ultérieure, si bien qu’aucun édifice antique majeur n’est intact dans la Valence actuelle (Les origines de la colonie romaine de Valence. – Persée). Seuls des objets et fragments architecturaux mis au jour lors de fouilles rappellent aujourd’hui ce passé gallo-romain, conservés pour partie au musée de Valence.
Moyen Âge
(File:Cathédrâle Saint-Apollinaire de Valence (Drôme).JPG – Wikimedia Commons) La cathédrale Saint-Apollinaire de Valence, édifiée aux XI^e–XII^e siècles, constitue un héritage majeur du Moyen Âge valentinois.
À la chute de l’Empire romain, Valence traverse les tumultes de l’Antiquité tardive puis s’affirme dès le haut Moyen Âge comme le siège d’un évêché. La tradition attribue l’évangélisation de la cité à un saint Apollinaire, et le premier évêque attesté apparaît au IV^e siècle. À partir du VI^e siècle, Valence s’intègre successivement aux royaumes burgonde puis franc, tout en conservant son importance religieuse. Durant tout le Moyen Âge, le pouvoir local est marqué par la double autorité du comte et de l’évêque. L’évêque de Valence, détenteur de la seigneurie épiscopale, et le comte de Valentinois (seigneur du territoire environnant) se disputent la suprématie sur la ville (Valence (Drôme) — Wikipédia). Finalement, l’évêque exerce la prééminence symbolique, le comte de Valentinois étant contraint de lui prêter hommage pour la ville même (Valence (Drôme) — Wikipédia). La cité médiévale de Valence reste relativement modeste en superficie, circonscrite par des remparts dont le tracé épouse en partie celui de l’ancienne muraille romaine tardive. Le Rhône constitue durant des siècles une frontière : jusqu’au XIV^e siècle, il sépare le Dauphiné (dont Valence fait partie) du royaume de France à l’ouest, ce qui confère à Valence le rôle stratégique de place-frontière face à la couronne de France (Vieux Valence — Wikipédia). Cette position explique que la ville soit convoitée et doive se fortifier : elle subit ainsi des sièges ou occupations au gré des conflits féodaux de la région.
Aux XI^e–XII^e siècles, l’autorité des évêques favorise un essor urbain marqué par la construction d’édifices religieux. La cathédrale Saint-Apollinaire est édifiée de 1063 à 1099 sous l’épiscopat de l’évêque Gontard, dans un style roman provençal sobre (Vieux Valence — Wikipédia). Cet édifice, consacré par le pape Urbain II, est le monument médiéval le plus emblématique de Valence. D’autres institutions ecclésiastiques s’implantent, telle l’abbaye Saint-Ruf fondée au XII^e siècle, dont les chanoines réguliers joueront un rôle intellectuel et spirituel notable. Sur le plan civil, la ville obtient une charte de consulat (institution municipale) au XIII^e siècle, témoignant d’une certaine autonomie urbaine dans le sillage du grand mouvement communal. Néanmoins, le pouvoir épiscopal demeure prépondérant jusqu’à la fin du Moyen Âge. En 1349, la province du Dauphiné – à laquelle Valence est rattachée – est officiellement intégrée au royaume de France (Valence (Drôme) — Wikipédia). Un siècle plus tard, le titre et les terres des comtes de Valentinois disparaissent : le dernier comte, Louis II de Poitiers, meurt sans héritier et, par le jeu des successions et cessions (notamment une vente en 1419 par sa fille Louise de Poitiers), le comté de Valentinois est définitivement rattaché au Dauphiné et donc à la couronne française (Valence (Drôme) — Wikipédia). Valence devient alors pleinement une cité du royaume de France, cessant d’être ville-frontière.

Du point de vue architectural, peu de bâtiments civils du Moyen Âge valentinois subsistent en élévation en dehors des édifices religieux. La cathédrale Saint-Apollinaire, malgré les remaniements ultérieurs, demeure le témoignage central de l’art médiéval dans la ville. On note également des vestiges de l’enceinte médiévale et de tours de défense intégrées çà et là dans le tissu urbain ancien. À la fin du Moyen Âge, Valence compte environ 6 000 habitants et présente l’aspect d’une petite cité épiscopale fortifiée, structurée autour de la cathédrale et du palais épiscopal (situé sur l’actuelle place des Ormeaux). La ville commence alors à s’étendre hors les murs vers la basse plaine riveraine du Rhône, préfigurant son expansion des siècles suivants.
Époque moderne (XVI^e–XVIII^e siècles)
Le début de l’époque moderne marque une période de renouveau et d’enrichissement pour Valence. En 1452, le dauphin Louis (fils du roi Charles VII, futur Louis XI) fonde l’Université de Valence, dotée initialement de facultés de droit, de médecine, de théologie et des arts (Valence (Drôme) — Wikipédia). Cette université attire rapidement des professeurs de grand renom – par exemple le juriste Jacques Cujas au XVI^e siècle – et confère à Valence un rayonnement intellectuel notable dans la région. La présence d’étudiants et d’érudits dynamise la vie culturelle locale. Sur le plan économique, la ville profite de sa situation sur le Rhône : à la fin du XVe siècle, Valence est connue comme la “capitale du halage” sur le fleuve, car elle constitue une étape majeure où s’organisent les équipes de haleurs tirant à bras d’homme les embarcations vers le nord contre le courant (Valence (Drôme) — Wikipédia). Ce rôle stratégique dans le commerce fluvial se maintient jusqu’à ce que la traction animale (chevaux de halage) puis les bateaux à vapeur remplacent progressivement les haleurs humains au cours du XVI^e siècle (Valence (Drôme) — Wikipédia) (Valence (Drôme) — Wikipédia). La prospérité de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance se traduit dans le paysage urbain par l’édification de belles demeures et monuments civils. Un exemple marquant est la Maison des Têtes, hôtel particulier à la façade richement sculptée construit entre 1528 et 1532 par Antoine de Dorne (un notable humaniste de la ville) (Valence (Drôme) — Wikipédia). De style gothique tardif mêlé d’éléments Renaissance, cette maison doit son nom aux nombreuses têtes et figures qui ornent sa façade. De même, le Pendentif, un monument funéraire de 1548 en forme d’arc triomphal, illustre l’architecture Renaissance à Valence. La construction de ces édifices, tout comme la rénovation de l’hôtel de ville et de plusieurs palais, témoigne de l’âge d’or que connaît la cité au début du XVI^e siècle (Valence (Drôme) — Wikipédia).
Cette prospérité est brutalement interrompue par les conflits religieux qui ravagent la France au XVI^e siècle. En 1562, durant la première guerre de Religion, Valence est investie par une troupe protestante menée par le baron des Adrets. Les Protestants s’emparent de la ville et vandalisent les symboles du catholicisme : la cathédrale Saint-Apollinaire est saccagée et partiellement détruite, tout comme l’abbaye Saint-Ruf et la plupart des églises (Valence (Drôme) — Wikipédia). Le clocher roman de la cathédrale s’effondre et nombre de sculptures ou reliques sont endommagées. L’ancienne abbaye bénédictine d’Épervière, en périphérie, est quant à elle ruinée et ne sera jamais relevée (Valence (Drôme) — Wikipédia). Après cet épisode tumultueux, la ville est reprise en main par les catholiques et retrouve une certaine stabilité à la fin du XVI^e siècle grâce à l’Édit de Nantes (1598) qui apaise les tensions. Au XVII^e siècle, Valence s’affirme davantage comme centre administratif, judiciaire et religieux. Plusieurs communautés religieuses (ordres mendiants, Ursulines, etc.) s’installent en ville, renforçant son caractère clérical (Vieux Valence — Wikipédia). L’économie, en revanche, stagne quelque peu : la situation de ville frontière sur le Rhône est moins cruciale désormais puisque le Dauphiné fait partie intégrante du royaume de France. Valence reste toutefois une place forte militaire secondaire ; une citadelle est aménagée au XVI^e siècle au nord de la ville pour en renforcer la défense (Vieux Valence — Wikipédia), et la garnison royale constitue une ressource non négligeable pour l’artisanat local (fourbisseurs, charrons, etc.).
Aux XVII^e–XVIII^e siècles, la vie quotidienne de la cité s’organise autour de sa fonction de chef-lieu du sud Dauphiné : Valence abrite un siège épiscopal, un tribunal royal (présidial) et une administration provinciale subalterne par rapport à Grenoble (capitale du Dauphiné). La population oscille autour de 8 000 habitants au XVIII^e siècle. La ville doit fréquemment loger des régiments de passage, ce qui pèse sur les habitants. Pour remédier à ce problème, de nouvelles casernes militaires sont construites dans le quartier de la Grande Barralie à partir de 1714 (Valence (Drôme) — Wikipédia). Malgré ces défis, la période voit également quelques faits marquants : en 1755, le célèbre contrebandier dauphinois Louis Mandrin est exécuté à Valence sur la place des Clercs, événement qui impressionne les contemporains (Valence (Drôme) — Wikipédia). À la veille de la Révolution française, Valence est une ville dont l’élite éclairée (parmi laquelle on compte des professeurs de l’université, des magistrats et des négociants) est acquise aux idées nouvelles, tandis que la masse de la population souffre de la crise économique et des disettes des années 1780.

Révolution française et XIX^e siècle
La Révolution de 1789 transforme le cadre politique de Valence. Dès l’annonce de la prise de la Bastille, les Valentinois s’enthousiasment pour le mouvement révolutionnaire. En 1790, le vieil ordre provincial est aboli et la ville devient le chef-lieu du nouveau département de la Drôme, créé dans le découpage administratif révolutionnaire. Valence obtient ainsi le statut de préfecture, concentrant les fonctions administratives sur le territoire drômois. La population locale participe activement aux événements révolutionnaires : par exemple, le 31 janvier 1790, Valence accueille une grande Fête de la Fédération réunissant quelque 16 000 gardes nationaux venus de 293 communes afin de célébrer l’unité nouvelle de la Nation (Valence (Drôme) — Wikipédia) (Valence (Drôme) — Wikipédia). Durant la période troublée de la Terreur (1793–94), la Drôme n’est pas épargnée par la répression politique, et plusieurs figures locales sont guillotinées. Toutefois, la ville de Valence ne subit pas de destruction majeure et sort de la Révolution avec un rôle administratif confirmé. C’est à Valence qu’avait séjourné, quelques années avant la tourmente révolutionnaire, un jeune officier corse du nom de Napoléon Bonaparte : affecté comme sous-lieutenant d’artillerie à la caserne de Valence en 1785–1786, le futur empereur y fit ses premières armes et y revint à plusieurs reprises par la suite (Valence (Drôme) — Wikipédia). Cette anecdote, bien que marginale à l’époque, est devenue un élément de fierté historique locale. Sous le Premier Empire (1804–1814), Valence fournit son contingent de soldats aux armées napoléoniennes et voit passer Napoléon lui-même en 1805 et 1807 lors de ses voyages vers le sud de la France (Valence (Drôme) — Wikipédia). Après la chute de Napoléon, la ville accueille en 1814 des troupes autrichiennes lors de l’invasion alliée, puis se rallie sans heurts à la Restauration.

Le XIX^e siècle constitue pour Valence une période de forte croissance démographique et de modernisation urbaine. Au sortir des guerres napoléoniennes, la ville compte environ 7 000 habitants. Cette population va presque quadrupler en l’espace d’un siècle : Valence passe de 7 000 habitants au début du XIX^e siècle à près de 27 000 à l’aube du XX^e siècle (Les grandes mutations de valence au 19e siècle, balades et parcours du patrimoine). Plusieurs facteurs expliquent cette expansion. D’une part, l’industrialisation gagne la région à partir des années 1830–1850 : Valence voit s’implanter des petites industries agroalimentaires (minoteries, brasseries), des ateliers de textile et de métallurgie, profitant de la position de carrefour de la ville. D’autre part, la révolution des transports profite directement à Valence avec l’arrivée du chemin de fer : la ligne Paris-Lyon-Marseille du PLM atteint Valence dans les années 1850, et la gare de Valence-Ville est inaugurée en 1865, plaçant la cité sur l’axe ferroviaire majeur du pays (Valence (Drôme) — Wikipédia). Le chemin de fer stimule le commerce local (exportation des vins, fruits et soieries de la région) et facilite l’arrivée de nouvelles populations ouvrières. En parallèle, la ville se transforme physiquement. À partir de 1854, les anciennes fortifications médiévales sont progressivement démantelées, ce qui permet de repousser les limites urbaines et d’aménager de larges boulevards à la place des remparts (Valence (Drôme) — Wikipédia). Ces boulevards circulaires (Boulevard Bancel, Boulevard Vauban, etc.) ouvrent la ville sur l’extérieur et deviennent de nouveaux axes de prestige bordés d’habitations bourgeoises. Le cœur historique se dote d’équipements modernes : un théâtre municipal ouvre en 1837, une nouvelle hôtel de ville est construit en 1894, et le musée de Valence est fondé en 1850 pour valoriser les arts et l’archéologie (Valence (Drôme) — Wikipédia).
(File:Valence kiosque Peynet.jpg – Wikimedia Commons) Le kiosque Peynet sur le Champ de Mars à Valence, construit en 1890, est un kiosque à musique devenu emblématique de la ville.
Plusieurs aménagements embellissent Valence à la fin du XIX^e siècle, symbole de son entrée dans la modernité. Le Champ de Mars, grande esplanade créée sous la Monarchie de Juillet, est transformé en promenade arborée offrant une vue sur le Rhône et le château de Crussol au loin. On y érige en 1887 une élégante fontaine monumentale, ornée de statues allégoriques, œuvre du sculpteur valencien Eugène Poitoux (Valence (Drôme) — Wikipédia). En 1890, un kiosque à musique métallique de style Belle Époque est édifié sur le Champ de Mars – il deviendra plus tard le célèbre kiosque Peynet, du nom du dessinateur qui l’illustra en 1942. Par ailleurs, la municipalité entreprend de doter la ville d’espaces verts : le parc Jouvet, un jardin public de 7 ha en bordure du centre, est inauguré en 1905 grâce à une donation du bienfaiteur Théodore Jouvet (Valence (Drôme) — Wikipédia). Ces réalisations contribuent à la qualité de vie urbaine et attestent du dynamisme de Valence à la veille du XX^e siècle. À cette époque, la ville est devenue la deuxième plus grande du Dauphiné (après Grenoble), avec une bourgeoisie florissante (négociants, industriels, professions libérales) et une classe populaire nombreuse travaillant dans l’artisanat, l’industrie ou les transports.
XX^e siècle
Le XX^e siècle est marqué par les conflits mondiaux et de profonds bouleversements socio-économiques, auxquels Valence n’échappe pas. La Première Guerre mondiale (1914–1918) coûte la vie à des centaines de jeunes Valentinois tombés sur les champs de bataille de l’Est et de la Somme. Comme partout en France, un monument aux morts – une statue du Poilu – est érigé en 1922 sur le Champ de Mars pour honorer ces sacrifices. L’entre-deux-guerres voit la ville traverser des périodes difficiles (crise économique des années 1930) mais également s’ouvrir à de nouvelles populations. Valence accueille notamment une importante communauté arménienne : à la suite du génocide de 1915 et de l’exode des Arméniens de l’Empire ottoman, plusieurs centaines de familles trouvent refuge dans la Drôme. Au milieu du XX^e siècle, la communauté arménienne de Valence atteint environ 2 500 personnes, soit près de 6 % de la population locale, faisant de Valence l’un des principaux pôles arméniens de France (Valence (Drôme) — Wikipédia). Ces nouveaux habitants contribuent à la vie économique (création d’ateliers de confection, de commerce) et enrichissent le tissu culturel de la cité tout en y conservant leur identité (fondation d’églises arméniennes, associations culturelles, etc.).
La Seconde Guerre mondiale (1939–1945) constitue une épreuve majeure pour Valence. Après la défaite de 1940, la ville se retrouve en zone libre jusqu’en 1942, accueillant des réfugiés du nord de la France. Toutefois, à partir de novembre 1942, l’occupation allemande s’installe dans la région. Valence subit plusieurs bombardements alliés en 1944 en raison de son importance stratégique (nœud ferroviaire et ponts sur le Rhône). Le 27 mai 1944, un raid aérien massif détruit notamment la gare de triage de Portes-lès-Valence (au sud de la ville) où des dizaines de locomotives sont anéanties (Valence (Drôme) — Wikipédia). Surtout, le bombardement du 15 août 1944 dévaste le centre-ville et les quartiers riverains du Rhône : l’hôpital, le grand séminaire et le palais épiscopal (alors siège de la préfecture) sont en grande partie détruits, et on dénombre plus de 280 victimes civiles (Valence (Drôme) — Wikipédia). Ce bombardement laisse Valence en ruines partielles à la veille de la Libération. Quelques semaines plus tard, fin août 1944, les résistants valentinois de la FTP et des FFI engagent l’insurrection contre l’occupant. La ville est libérée le 31 août 1944 par les Forces françaises de l’intérieur, avant l’arrivée des troupes alliées américaines le jour suivant (Valence (Drôme) — Wikipédia). Cet épisode place Valence dans la liste des villes décorées de la Croix de guerre 1939–1945 pour le courage de sa population. La période de l’Occupation et de la Libération a profondément marqué la mémoire locale, et un monument commémoratif ainsi que des plaques rappellent ces événements dans la ville.

Après 1945 commence la période des Trente Glorieuses, trente années de forte croissance économique et de transformations sociales. Valence se relève des destructions de la guerre grâce à un vaste effort de reconstruction: de nouveaux bâtiments modernes remplacent les immeubles éventrés sur les boulevards et les quais du Rhône, la préfecture et l’hôpital sont rebâtis, et les ponts sur le Rhône sont remis en service. Dans les années 1950–1970, la ville connaît un véritable boom démographique alimenté par l’exode rural et l’essor industriel français. Sa population passe d’environ 40 000 habitants en 1954 à plus de 60 000 à la fin des années 1970, atteignant son maximum historique (autour de 68 000) vers 1982. Pour faire face à la crise du logement des années 1950, la municipalité construit des grands ensembles en périphérie : le quartier de Fontbarlettes au nord et le quartier du Plan à l’est voient le jour dans les années 1960, avec leurs barres et tours d’habitation caractéristiques. Ces nouveaux quartiers populaires accueillent notamment des rapatriés d’Algérie en 1962 et des ouvriers attirés par les emplois industriels. Valence s’étend géographiquement et absorbe des communes voisines (Cambrousse, Châteauvert) tout en modernisant ses infrastructures. En 1967, l’autoroute A7 (Autoroute du Soleil) est ouverte à l’est de Valence, améliorant la desserte routière vers Lyon et Marseille. L’économie locale, traditionnellement basée sur le négoce agricole et quelques fabriques, se diversifie avec l’installation d’établissements de la métallurgie, de la chimie (usine de Terreau en 1951) et d’entreprises publiques (dépôt SNCF, ateliers EDF). La vie culturelle se développe également : une scène nationale (le Théâtre de la Ville) est créée, et la tradition d’enseignement supérieur renaît avec l’implantation progressive d’antennes universitaires dans les années 1970 (aboutissant à la création d’un centre universitaire valentinois rattaché à Grenoble dans les années 1980) (Valence (Drôme) — Wikipédia). En 1983, Valence inaugure son centre hospitalier moderne (hôpital de Valence) dans le quartier de Laville. À la fin du XX^e siècle, bien que Valence subisse comme beaucoup de villes moyennes le ralentissement industriel et la montée du chômage, elle affirme son rôle de capitale administrative et de services pour le sud de la région Rhône-Alpes.
Période contemporaine (XXI^e siècle)
À l’orée du XXI^e siècle, Valence poursuit son évolution en s’adaptant aux enjeux contemporains, qu’ils soient économiques, urbains ou culturels. La ville s’intègre dans de nouvelles dynamiques territoriales : en 2014, elle devient le cœur d’une agglomération élargie (Valence Romans Agglo) englobant la ville voisine de Romans-sur-Isère, afin de mutualiser les ressources et de renforcer l’attractivité du bassin valentinois. Sur le plan des transports, un événement majeur est l’ouverture de la gare de Valence TGV en 2001 sur la ligne à grande vitesse Méditerranée, à quelques kilomètres au nord-est du centre-ville (Valence (Drôme) — Wikipédia). Cette gare TGV connecte Valence au réseau ferroviaire à grande vitesse (seulement 2h10 de Paris), stimulant le tourisme d’affaires et facilitant les déplacements des habitants. Parallèlement, la ville améliore ses liaisons locales avec la mise en place d’un réseau de bus performant et le développement d’infrastructures cyclables, contribuant à une mobilité urbaine durable.
D’un point de vue urbanistique, Valence entreprend depuis les années 2000 de grands projets de renouvellement urbain pour améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale. Les anciens grands ensembles construits dans l’urgence des années 1960 font l’objet d’importantes réhabilitations : le quartier de Fontbarlettes et le quartier du Plan, classés en politique de la ville, bénéficient de programmes de rénovation visant à casser l’isolement de ces zones, à diversifier l’habitat et à créer de nouveaux équipements publics (Valence (Drôme) — Wikipédia). Dans le même temps, le centre historique connaît une mise en valeur de son patrimoine : ravalement de façades, piétonnisation de certaines rues commerçantes (rue Saint-James, etc.), ouverture de musées rénovés. Les berges du Rhône ont été réaménagées pour redonner aux habitants l’accès au fleuve : un parc urbain en rive droite et une promenade piétonne ont vu le jour, transformant d’anciens secteurs industriels ou friches portuaires en espaces verts conviviaux (Valence (Drôme) — Wikipédia). Ces projets illustrent la volonté de la ville de conjuguer héritage historique et développement durable.
Sur le plan économique, Valence au XXI^e siècle s’appuie sur une économie diversifiée. Le secteur agroalimentaire demeure important (la Drôme étant un terroir agricole réputé), tandis que des industries de pointe se sont implantées dans l’agglomération – par exemple dans l’électronique, la mécanique de précision et le traitement de l’image. Le parc technologique de Rovaltain, près de la gare TGV, accueille des entreprises innovantes et des laboratoires de recherche, consolidant la vocation de pôle technologique émergent de Valence. La ville mise aussi sur les filières créatives : un pôle d’excellence en cinéma d’animation s’est développé autour de l’ancienne Cartoucherie de Bourg-lès-Valence, accueillant des studios et une école réputée, ce qui confère à Valence une notoriété dans ce domaine au niveau national. Par ailleurs, le secteur tertiaire prédomine aujourd’hui dans l’emploi local, avec de nombreux postes dans l’administration (préfecture, collectivités), l’enseignement (université, écoles d’ingénieurs), la santé (hôpital, cliniques) et le commerce.
Enfin, la vie culturelle et patrimoniale de Valence s’est affirmée au cours des deux dernières décennies. La rénovation du Musée de Valence (arts et archéologie), rouvert en 2013, a permis de valoriser deux millénaires d’histoire locale à travers des collections riches, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. La ville a obtenu en 2010 le label officiel de “Ville d’Art et d’Histoire”, reconnaissant la richesse de son patrimoine bâti et de son architecture, depuis les vestiges romains jusqu’aux créations contemporaines (Valence (Drôme) — Wikipédia). De nombreuses manifestations culturelles rythment l’année, telles que le festival Vochora (musique classique), le festival d’humour de Valence ou encore des Biennales d’art contemporain, qui attirent un public régional. Valence met également en avant son identité multiculturelle, héritée de son histoire migratoire : la communauté arménienne, forte d’environ 5 000 membres aujourd’hui, participe activement à la vie culturelle locale (festivals, gastronomie, jumelages internationaux). De même, les populations originaires d’Afrique du Nord ou d’Italie, installées depuis plusieurs générations, ont enrichi le patrimoine immatériel de la cité.
À l’horizon de 2025, Valence apparaît comme une ville moyenne dynamique, alliant un passé historique riche à des perspectives d’avenir tournées vers l’innovation et le développement équilibré. Forte d’environ 64 000 habitants (près de 130 000 dans son agglomération), elle demeure un carrefour entre le nord et le sud de la France, fidèle en cela à sa vocation bimillénaire. Les défis contemporains ne manquent pas – revitalisation du centre-ville, transition écologique, attractivité économique – mais la ville dispose d’atouts historiques et géographiques pour y répondre. L’histoire de Valence, depuis la colonie romaine de Valentia jusqu’à la cité moderne du XXI^e siècle, témoigne d’une continuité urbaine et humaine remarquable au fil des siècles, où chaque époque a laissé son empreinte dans la trame urbaine et l’identité locale. Les monuments tels que la cathédrale médiévale, la Maison des Têtes Renaissance, le kiosque Peynet Belle-Époque ou les architectures contemporaines du quartier de l’Espérance constituent autant de jalons visibles de cette longue histoire, rappelant que la ville de Valence conjugue au présent tous les temps de son passé.
Sources principales : Archives municipales et départementales, publications académiques et sites officiels ont permis de retracer cette histoire. Les informations et citations sont issues notamment du site de la ville de Valence, du label Ville d’art et d’histoire, des travaux d’historiens publiés (Persée) ainsi que de synthèses encyclopédiques validées (Valence (Drôme) — Wikipédia) (Vieux Valence — Wikipédia) (Valence (Drôme) — Wikipédia) (Valence (Drôme) — Wikipédia), garantissant la fiabilité des faits rapportés.